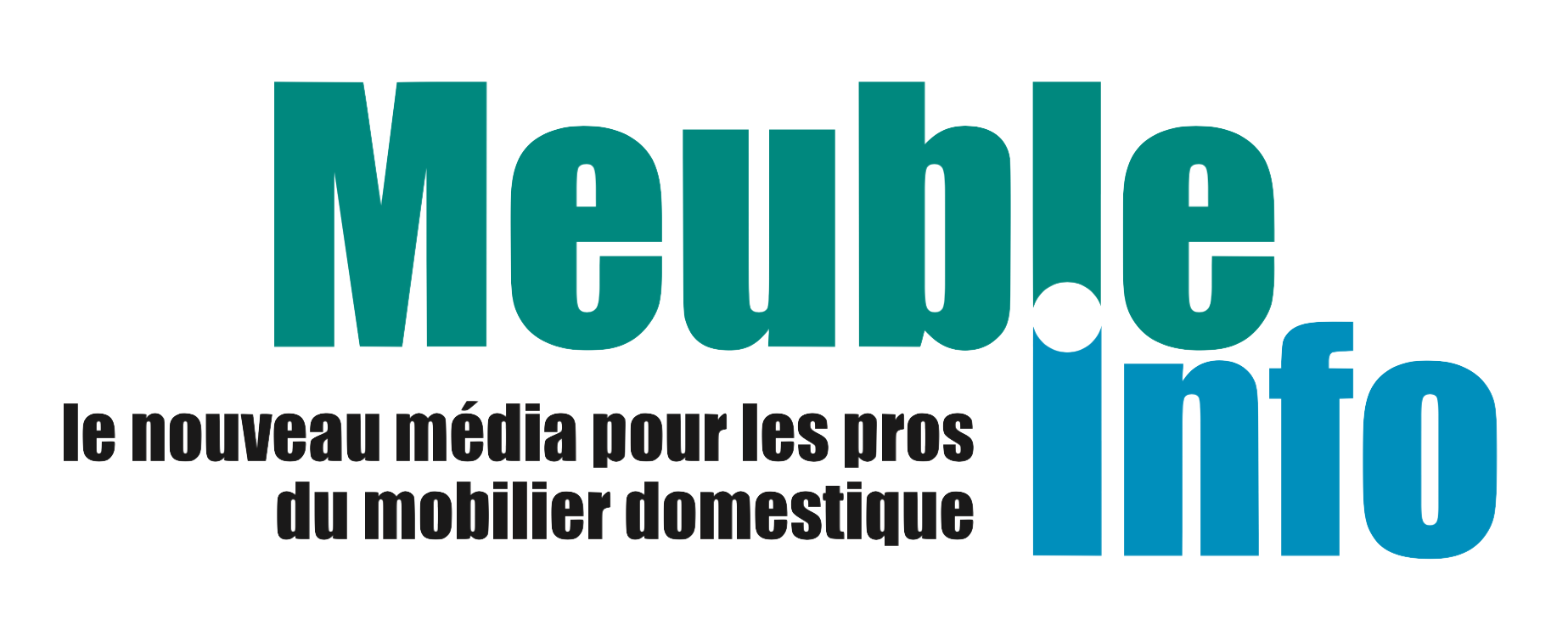Au menu 2025 des Français : moins de convivialité et de repas partagés ; plus de consommation rapide et individuelle ; diversité croissante des régimes alimentaires et fragmentation des achats. Les mutations en cours des pratiques alimentaires de nos concitoyens risquent-elles de bouleverser la/les fonction(s) des pièces “cuisine” et “salle à manger” ; et, ce faisant, l’aménagement même de ces espaces ?
Une enquête qui semble donner raison aux enseignes cuisinistes qui mettent en avant des cuisines parfaitement esthétiques et optimisées pour… toutes sortes d’activités autres que cuisiner ! ; à l’instar, soit dit en passant, des fabricants de voitures qui, depuis belle lurette, ne vendent plus ni pointe de vitesse, ni signe extérieur de richesse, mais bien plutôt des services, de l’usage et du rêve… À méditer, tant pour la pièce “cuisine” d’ailleurs, que pour la pièce “salle à manger”.
Comment mange la France en 2025 ? La nouvelle édition de “l’Observatoire Éthiques et qualité alimentaires” de L’ObSoCo (L’Observatoire Société et Consommation) dresse le portrait d’un modèle alimentaire français en profonde mutation, où l’acte de se nourrir cristallise toutes les tensions de notre société. Les chiffres de cette seconde édition interpellent : 57 % des Français considèrent aujourd’hui que leur alimentation leur procure du plaisir, soit 16 points de moins qu’en 2016 ! « Une érosion du plaisir de manger, avancent les experts de L’ObSoCo, qui traduit un rapport de plus en plus contraint à l’alimentation », où 37 % des Français doivent désormais restreindre leurs dépenses alimentaires pour des raisons économiques, dont 11 % font face à d’importantes restrictions.
« Cette contrainte budgétaire transforme radicalement les comportements, poursuit l’Observatoire : descente en gamme, arbitrages systématiques en faveur du prix au détriment de la qualité, évitement des grandes marques. Un phénomène qui creuse les inégalités alimentaires et prive certains ménages d’un accès à une alimentation choisie. Paradoxe de notre époque : alors que 60 % des Français se disent préoccupés par l’impact des aliments qu’ils consomment sur leur santé (+4 points depuis 2021), l’attention réellement portée à ces effets diminue. Tout se passe comme si nous n’avions pas toujours les moyens de notre inquiétude ». Dans ce contexte d’ailleurs, l’étude révèle également une crise de confiance majeure envers l’écosystème agroalimentaire. La défiance grandit envers les grandes marques alimentaires, perçues comme trop chères sans offrir de réels bénéfices, tandis que les marques de distributeur (MDD) gagnent en légitimité : 69 % de nos concitoyens estiment désormais que leur qualité équivaut à celle des grandes marques et 8 % leur attribuent même une qualité supérieure.

Plus édifiant encore : face à ces bouleversements, les pratiques alimentaires se transforment : multiplication des régimes spécifiques (un Français sur trois suit désormais un régime particulier : sans viande, sans gluten, flexitarien…) ; individualisation croissante des repas (43 % dînent seuls à la maison, contre 29 % vingt ans plus tôt : en d’autres termes, le repas partagé se dissout progressivement dans les pratiques individuelles) ; et diversification des sources d’approvisionnement. Les Français fréquentent ainsi, en moyenne, 5,3 types de commerces alimentaires différents, pour 3,3 en 2019, signe d’une stratégie d’achat de plus en plus éclatée. Au passage, cette évolution pose un défi majeur à la grande distribution, qui voit sa position dominante s’éroder face à la montée des spécialistes alimentaires.
Au-delà des chiffres, cette enquête interroge notre capacité collective à préserver ce qui fait la singularité française : le plaisir de manger et la convivialité de la table. Tenez-vous bien ! : 53 % des Français passent moins de trente minutes à table, contre 38 % en 1999 ; le temps du repas se comprime irrémédiablement (sous l’effet du rythme de nos vies et du manque de disponibilité ?), tandis que le poids du quotidien alimentaire, même bouleversé, continue de reposer massivement… sur les femmes, révélant des inégalités genrées persistantes (70 % d’entre elles déclarent assumer seules les courses et la préparation des repas).
« Entre pressions économiques, manque de temps et surcharge informationnelle, comment maintenir un rapport apaisé à l’alimentation ?, interroge L’ObSoCo en guise de conclusion. Comment garantir que la qualité nutritionnelle ne devienne pas un privilège de classe ? L’alimentation, miroir de nos inégalités et de nos aspirations, révèle les tensions d’une société en quête d’équilibre entre idéal et réalité, tradition et modernité ». Et l’Observatoire d’inviter à lire “La France à table, 2e édition – Tensions et mutations autour de notre rapport à l’alimentation”, par Guénaëlle Gault et Agnès Crozet (téléchargeable ici).
(Source : Le coup d’œil de L’ObSoCo, 13/06/2025)
(Photos : © Freepik.)